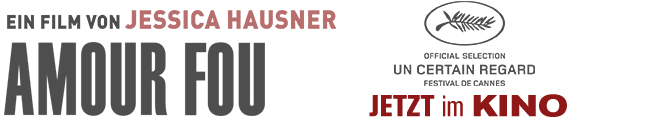La froideur du ciel
Le cinéma de Jessica Hausner, ou : considérations sur le caractère arbitraire des événements
Dans Cold Heaven, film merveilleux mais lugubre et méconnu de Nicolas Roeg, un jeune homme impliqué dans un grave accident revient chez lui bien qu’on l’ait cru mort. Sa femme ne semble guère enchantée de le revoir et refuse obstinément de rendre grâce pour ce qui apparaît comme un miracle. Avec pour résultat un malaise face à une situation où se mêlent la folie, l’étrangeté et le sentiment d’injustice. Comme dans d’autres récits abordant la métaphysique, la transcendance, la religion et la foi — notamment Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos —, le miracle conduit les personnages à douter de l’ordre des choses et à craindre Dieu outre mesure. Comme si celui qui a été touché par la grâce péchait en concevant que ladite grâce, précisément, n’était que charlatanisme et tromperie volontairement consentie. Jusqu’à quel point peut-on douter de ce qu’on perçoit ? Voilà un sujet de prédilection pour la grande machine à illusions qu’est le cinéma.
Il peut paraître déplacé de mentionner un tel film au début d’un article visant à rendre hommage à l’œuvre cinématographique de Jessica Hausner. Pour parler de l’équilibre entre distanciation et focalisation sur des détails concrets dans les films de cette réalisatrice, n’aurait-il pas mieux valu évoquer les tableaux de son père Rudolf ou de sa demi-sœur Xenia ? Et pourtant : lorsque son film Lourdes est sorti en 2009, on a bien eu l’impression — rare à notre époque — d’être en face d’un texte riche, d’un récit qui prend des risques en essayant de rendre compte à la fois des pulsions humaines et des mécanismes sociaux, et cela tout en conservant une part de mystère.
On aurait pu penser que ce film allait moquer avec suffisance les rituels catholiques, mais la réalisatrice a su aborder avec respect le sanctuaire de Lourdes et l’espérance qui porte ces pèlerins gravement malades, tout en rendant compte à la fois de l’aspect commercial et touristique des pèlerinages, et du contraste entre le quotidien et le caractère exceptionnel des promesses de guérison et de salut. Sans sombrer dans une polémique facile, Lourdes est un film qui aborde la question de la foi, toujours présente à notre époque mais qui tend à devenir un sujet tabou sous la pression des divers intégrismes. C’est un conte, en quelque sorte, mais revêtu des attributs du documentaire — Un film à la fois fantastique et terre-à-terre.
Le thème du miracle et de l’illusion est repris dans Lourdes, ce qui ne saurait surprendre s’agissant d’un film tourné dans un lieu à tel point entouré de mystère. On y voit une jeune femme (Sylvie Testud) se lever de son fauteuil roulant… pour s’y effondrer de nouveau dans les scènes finales. Plusieurs grilles de lecture sont possibles face à la guérison et la rechute décrites par Jessica Hausner : description d’une industrialisation du miracle et de l’espoir qui rend sceptiques même certains catholiques ; documentaire sur le type de communication au quotidien entre les malades et leurs accompagnateurs et sur la manière dont elle peut être remise en question par un événement imprévu ; ou encore représentation laconique de la jalousie pouvant opposer des malades ayant déjà effectué plusieurs pèlerinages à une jeune femme guérie dès de son premier séjour à Lourdes. Une réplique du film est significative à ce sujet : « Si ça ne dure pas, ce n’était pas un miracle. Et dans ce cas, Dieu n’y est pour rien ».
Dans une interview qu’elle nous a accordée, Jessica Hausner a déclaré : « Lourdes met en évidence le drame de l’existence. On espère que tout va s’arranger, qu’on va connaître l’amour, que quelqu’un va déployer un filet protecteur. Mais jour après jour, on constate que ce n’est pas le cas, que l’espace interstellaire est sombre et froid et qu’il va nous falloir mourir tôt ou tard. On fait pour le mieux, mais on n’est pas heureux pour autant, car d’autres facteurs sont en jeu, qu’on appelle “Dieu”, “le hasard” ou “le destin”. Et ces facteurs sont bel et bien les plus forts. Ce sont eux qui font que les choses prennent un tour inattendu et non souhaité. Nous sommes face à un adversaire puissant, qui joue un rôle déterminant dans l’arbitraire des événements ».
L’arbitraire des événements — Jessica Hausner est née en 1972 et n’a jusqu’à présent réalisé que quatre longs-métrages. Dans ces conditions, on n’ose guère réduire son œuvre à un thème central. Des constantes semblent néanmoins se détacher dans les portraits de femmes qu’elle a donnés avec Lovely Rita (2000), Hotel (2004), Lourdes (2009) et maintenant Amour fou (2014).
Dans chacun de ces films, la cinéaste nous présente une jeune femme qui est soit frappée d’un mutisme qu’on peut interpréter comme un blocage, un refus ou de l’indifférence face à la rigidité des structures sociales qui l’entourent, soit plongée dans un monde aux rituels oppressants, auquel elle semble inadaptée jusqu’à ce que les événements se précipitent et se retournent contre elle. Ce que Jessica Hausner a formulé en déclarant à propos d’Amour fou et de Henriette Vogel : « Les femmes qui m’intéressent le plus sont celles qui, gentilles de prime abord, se révèlent têtues et capables de résister à ce qu’on cherche à leur imposer. De telles femmes semblent bien sages, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive qu’elles serrent les poings dans leurs poches. Henriette Vogel était probablement une femme de ce genre ».
 Les héroïnes de Jessica Hausner ne sont pas des rebelles au sens propre. Les événements viennent rebondir sur elles — et cela avec une violence indéniable. Étrangères au monde qui les entoure, elles sont d’une indifférence éhontée qui finit par ébranler leur environnement hermétique et bien réglé, révélant ainsi son arbitraire et son instabilité. Dans Lovely Rita, le personnage principal est une jeune fille en décalage par rapport à un univers familial provincial et étriqué qui la mène à une catastrophe de manière quasiment inéluctable. Hotel met en scène l’employée d’un hôtel qui, par son mutisme et sa froideur, développe un rapport si intime avec la nature qu’elle se dissoudra finalement dans la forêt environnante, ce qui n’est pas sans rappeler Méfions-nous de la nature sauvage de la romancière Elfriede Jelinek. Lourdes, enfin, présente une paralysée dont le handicap pourrait être un moyen lui permettant de tester les gens avec lesquels elle est en relation, de les tenir à distance pour mieux discerner leur grandeur d’âme ou au contraire leur bassesse.
Les héroïnes de Jessica Hausner ne sont pas des rebelles au sens propre. Les événements viennent rebondir sur elles — et cela avec une violence indéniable. Étrangères au monde qui les entoure, elles sont d’une indifférence éhontée qui finit par ébranler leur environnement hermétique et bien réglé, révélant ainsi son arbitraire et son instabilité. Dans Lovely Rita, le personnage principal est une jeune fille en décalage par rapport à un univers familial provincial et étriqué qui la mène à une catastrophe de manière quasiment inéluctable. Hotel met en scène l’employée d’un hôtel qui, par son mutisme et sa froideur, développe un rapport si intime avec la nature qu’elle se dissoudra finalement dans la forêt environnante, ce qui n’est pas sans rappeler Méfions-nous de la nature sauvage de la romancière Elfriede Jelinek. Lourdes, enfin, présente une paralysée dont le handicap pourrait être un moyen lui permettant de tester les gens avec lesquels elle est en relation, de les tenir à distance pour mieux discerner leur grandeur d’âme ou au contraire leur bassesse.
Cette attitude qui consiste à prendre volontairement du recul par rapport à son entourage se retrouve dans le travail et les mises en scène de Jessica Hausner : « J’essaye toujours de prendre mes distances par rapport à l’histoire que je raconte. Qu’il s’agisse du récit, des acteurs ou du lieu de tournage, je fais systématiquement dix pas en arrière pour avoir une vue d’ensemble. Ce qui me porte à préférer les lieux étranges. Lourdes, par exemple, de même que la langue française, m’ont permis de jeter un regard encore plus froid sur l’histoire que j’entendais raconter ». D’un autre côté — et c’est bien là un des paradoxes qui font la valeur des grands conteurs —, cette distanciation a la propriété d’agir comme un verre grossissant. À telle enseigne que dans Lourdes, l’actrice principale présente une ressemblance frappante avec la réalisatrice. On aurait presque l’impression de voir Jessica Hausner dans le fauteuil roulant de Sylvie Testud, immobile mais entièrement occupée à sonder l’évidence des événements. Avec pour résultat sur la pellicule le suspense et un ébahissement radical mais jamais naïf.
Il conviendrait toutefois de ne pas confondre la froideur de Jessica Hausner avec un manque d’empathie. Lorsqu’on observe le monde avec attention comme elle le fait, que ce soit à la manière d’un entomologiste ou d’un metteur en scène de mélodrame qui, de prime abord, ne semble s’intéresser qu’aux costumes et aux décors, on en arrive forcément à disséquer les grandes émotions. Avant de réaliser Amour fou, par exemple, Jessica Hausner a étudié en profondeur divers textes de Kleist, notamment son Essai sur le théâtre des marionnettes, dans lequel il écrit en parlant de personnes amputées : « Si je vous dis que ces malheureux dansent, je crains fort que vous ayez du mal à me croire. – Mais que dis-je, danser ? Bien sûr, leurs mouvements ont une amplitude réduite, mais ceux qu’ils peuvent effectuer sont réalisés avec un calme, une souplesse et une grâce telles que toute âme sensible ne peut qu’en être émue ».
Dans les films de Jessica Hausner, l’émotion, l’ébahissement dont il est ici question s’expriment par des haussements de sourcils qui n’ambitionnent pas de changer le monde ni même de l’expliquer ou de le critiquer pour le rendre meilleur. Ces femmes dont on attend qu’elles s’adaptent le laissent tout bonnement tourner et « danser » tel qu’il est. C’est là que réside la charge dramatique inhérente à ces films. En prise directe avec la réalité la plus terre-à-terre, à mille lieues des drames documentaires fréquents dans le cinéma contemporain, ces œuvres reprennent une forme de communication entre les gens et les sexes issue des siècles passés. On pense à La Marquise d’O. de Kleist ou encore aux Amitiés électives de Goethe, et cela bien que Jessica Hausner n’ait pas eu besoin jusqu’à présent d’adapter à l’écran des œuvres littéraires pour réinventer le monde dans des films sans message ni tendance particulière.
Elle a pu déclarer : « J’essaye de décrire mes personnages à partir de leur rôle dans la société. C’est toujours intéressant de voir “qui je devrais être” et “qui cela me pousse à devenir”. D’une certaine manière, on se définit toujours par la manière dont on répond ou non à ce que notre entourage attend de nous. Toutes nos actions reflètent dans quelle mesure nous jouons ou non le rôle qui nous est imparti par la société, dans quelle mesure nous respectons les consignes. Les costumes, les uniformes sont à mon sens la manifestation visuelle de notre degré d’adaptation ».
Les films de Jessica Hausner montrent parfaitement ce que cela peut signifier pour les femmes.
Claus Philipp est un critique de cinéma né à Wels en 1966. Longtemps responsable de la rubrique Culture du quotidien autrichien Der Standard, il dirige depuis 2008 la société Stadtkino Filmverleih, qui diffuse le film Amour fou en Autriche.